Tarik Moudden : « La durabilité multidimensionnelle est l’impératif de notre époque »

Propos recueillis par Mouhamet Ndiongue
Le développement territorial est devenu de nos jours un enjeu central pour l’avenir du Maroc ainsi que la question de la durabilité, qui avec force, s’impose comme une nécessité impérieuse. C’est dans cette optique que Tarik Moudden, expert en développement territorial, propose une réflexion approfondie à travers son ouvrage « Propositions Harmonies durables pour un développement territorial responsable ». Ce livre, conçu comme un véritable recueil d’analyses et de pistes de réflexion, explore les fondements d’un développement territorial équilibré et inclusif, mettant en lumière des prérequis essentiels tels que la gouvernance, la participation citoyenne, l’anticipation stratégique, la convergence des politiques publiques, la cohésion sociale ou encore l’innovation.
Dans cet entretien accordé, Tarik Moudden revient sur les grands axes de son ouvrage, soulignant l’importance d’une approche holistique et intégrée pour assurer un développement harmonieux des territoires marocains. Il insiste sur la nécessité d’un cadre participatif et d’un suivi rigoureux des politiques mises en place, afin de garantir une transformation durable et respectueuse des spécificités locales. Plus qu’un simple état des lieux, son travail s’inscrit dans une démarche proactive, visant à sensibiliser et à engager les différents acteurs—décideurs, collectivités, société civile et citoyens—dans une dynamique de développement responsable et pérenne.
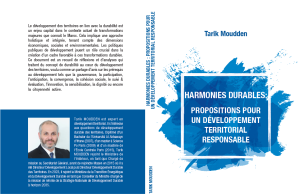
Maroc Diplomatique. Dans votre ouvrage, vous affirmez que le développement territorial durable exige une approche intégrée prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales. Selon vous, quelles sont les principales limites des politiques publiques actuelles en matière d’articulation entre ces trois dimensions ?
Tarik Moudden. Au lieu de parler de limites, je préfère personnellement parler de défis et qui sont à la fois structurels et conjoncturels touchant plusieurs secteurs. Les politiques publiques marocaines manquent parfois d’une véritable approche intégrée qui associe systématiquement les dimensions sociales, économiques et environnementales. Par exemple, si des politiques environnementales existent, leur mise en œuvre se heurte souvent à des enjeux économiques ou sociaux (notamment la question du développement industriel, des grands projets d’infrastructure ou de l’urbanisation). De la même manière, si le développement social ou économique est pris indépendamment des enjeux environnementaux, des projets d’infrastructure risquent d’être lancés sans tenir suffisamment compte des impacts environnementaux à long terme. Par ailleurs, le Maroc connaît encore des inégalités sociales et territoriales importantes avec un écart certain entre les zones urbaines et rurales, ou un accès limité à certains services (éducation, santé, emploi) pour une frange de la population, notamment en milieu rural. L’articulation entre le développement économique et la justice sociale est parfois insuffisante ; seule une approche initialement globale, inclusive et intégrée permettra d’apporter les réponses idoines pour une redistribution des richesses qui permette de réduire significativement ces inégalités.
Quelles réformes structurelles devraient être engagées en priorité pour y remédier?
Je pense que la déconcentration, la décentralisation et la régionalisation avancée peuvent être des leviers efficaces pour le développement territorial durable. Chacune de ces approches vise à rapprocher les décisions des citoyens et des territoires, mais elles ont des implications différentes et peuvent se compléter dans la mise en œuvre d’une stratégie de développement durable qui tienne compte des spécificités locales, des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Ces réformes, et qui sont déjà initiées au Maroc, pourront venir progressivement faire évoluer le paysage de développement permettant non seulement de mieux prendre en compte les spécificités locales, mais aussi de renforcer la gouvernance territoriale, la participation citoyenne et l’intégration des enjeux environnementaux dans les politiques publiques. Ces mécanismes de gouvernance pourront installer un mindset citoyen nouveau qui favoriserait une amélioration de l’efficacité de l’administration, une optimisation des ressources locales, une dynamisation de l’économie locale/territoriale, une planification intégrée voire un renforcement de la cohésion territoriale.
Votre livre met l’accent sur la gouvernance et la participation citoyenne comme leviers fondamentaux du développement territorial. Pourtant, dans la réalité marocaine, la centralisation excessive et le déficit de participation effective des citoyens aux décisions locales freinent souvent l’émergence d’une dynamique durable. Comment surmonter ces obstacles institutionnels et culturels ? Sommes-nous réellement prêts à une décentralisation effective ou est-ce encore un vœu pieux ?
Dire que c’est un vœu pieux, c’est avant tout une question de perspective et de volonté collective. Certes, certains objectifs peuvent sembler ambitieux ou difficiles à atteindre dans l’immédiat, mais rien n’est impossible si on s’y engage pleinement avec une vision claire, une planification rigoureuse et une mobilisation de tous les acteurs concernés.
La participation citoyenne est devenue une nécessité incontournable pour un développement territorial responsable, car elle permet de répondre de manière plus juste et équitable aux besoins locaux tout en garantissant la transparence et l’inclusivité des décisions publiques. Aujourd’hui, elle ne doit plus être perçue simplement comme un outil au service de la gestion publique, mais comme un droit fondamental des citoyens dans le cadre d’une gouvernance partagée. Pour que cette participation soit véritablement effective, elle nécessite d’être accompagnée de réformes structurelles et de mesures concrètes visant à préparer tous les acteurs concernés : les autorités publiques, les entreprises privées, mais aussi la société civile et les citoyens eux-mêmes. Cela implique de former les acteurs publics et privés à une gestion collaborative (management collaboratif), de renforcer la capacité d’engagement des citoyens (empowerment) à travers l’éducation civique et la sensibilisation aux enjeux locaux, et de garantir des mécanismes de dialogue et de concertation qui permettent une réelle prise en compte des avis et besoins exprimés. Ainsi, la participation citoyenne deviendra un levier puissant pour assurer un développement territorial durable et équitable.
Vous plaidez pour une approche territoriale soucieuse de la convergence et de l’anticipation face aux défis contemporains. Si nous nous projetons en 2050, quel visage imaginez-vous pour les territoires marocains dans une perspective de durabilité optimale ?
Je vais vous répondre de la manière la plus claire en donnant un exemple concret. Aujourd’hui, il existe une fragmentation tangible entre certains ministères en charge des dimensions sociales, environnementales et économiques. Par exemple, les ministères de la Transition Énergétique et du Développement Durable, de l’Économie et des Finances et de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille ont souvent des objectifs différents qui ne sont pas toujours territorialement coordonnés. Ainsi, des projets d’infrastructure peuvent parfois être lancés sans une coordination entre ces départements, ce qui entraîne des conflits d’intérêts entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
Avec mon optimisme et en me projetant en 2050, j’espère que les approches territorialisées considérant avec force l’anticipation et la convergence au cœur de leur modèle auront fait leur chemin et seront devenues la norme. Dans une perspective de durabilité optimale, le visage des territoires marocains pourrait se dessiner comme celui de régions résilientes, inclusives et équilibrées, où les dimensions sociales, économiques et environnementales se renforcent mutuellement. Chaque territoire, en fonction de ses spécificités géographiques et culturelles, serait conçu comme un acteur clé dans la transition vers un développement durable, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Le visage de nos territoires serait aussi celui de régions interconnectées et qui œuvrent ensemble dans un esprit de solidarité, de coopération et d’entraide, où le citoyen est valorisé, l’économie locale diversifiée et inclusive, et la société plus équitable. L’objectif serait d’assurer un développement harmonieux qui profite à tous.
Quels seraient les marqueurs d’un développement territorial pleinement réussi selon votre grille d’analyse ?
Eh bien, je crois que la réponse à votre question pourrait ressembler à une grille multicritères hyper-complexe, remplie de calculs ésotériques que même un supercalculateur ou même l’IA aurait du mal à traiter. Et, bien sûr, à la fin, un petit drapeau vert s’afficherait, comme pour nous dire « Voilà, tout est parfait ! Vous avez atteint l’eldorado du développement. » Mais en réalité, trouver un tel outil universel reste un peu un mythe moderne.
Il me semble qu’un développement territorial responsable et harmonieux devrait prendre en compte la soutenabilité à long terme, l’équité et la résilience. Il pourrait se mesurer à la confiance et à la satisfaction des citoyens en réaction à un niveau de développement œuvrant à une réduction des inégalités sociales et économiques entre les différents groupes de la population et entre les territoires eux-mêmes. Un territoire qui réussit son développement doit être un lieu où les habitants vivent dans un environnement de bien-être, d’épanouissement personnel et d’harmonie sociale et économique. N’oublions pas qu’il y a une dimension humaine très forte dans le développent territorial ; Un indicateur simple, mais essentiel !
Votre ouvrage évoque la notion de « dignité » comme un pilier du développement territorial responsable. Comment concilier la quête de dignité sociale des populations avec les impératifs d’un développement territorial souvent contraint par des logiques économiques globalisées qui exacerbent les inégalités entre régions ?
Pour mettre l’Homme au cœur des modèles de développement et garantir ainsi la pérennité des dynamiques de progrès, il serait plus qu’opportun de considérer la dignité́ humaine en tant que composante essentielle dans les processus participatifs de planification et comme objectif ultime SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) à atteindre. In fine, tout développement doit être humain et durable. Ces qualificatifs visent à placer la personne humaine au centre du développement en incluant tout ce dont un être humain a besoin pour bénéficier d’une vie décente conformément à sa dignité. Dans le chapitre dédié à la Dignité Humaine dans mon livre, je voulais défendre l’idée que la Dignité devrait être considérée comme un élément clé dans la programmation et la planification d’une politique de développement performante. En quelque sorte, il s’agirait de s’inspirer des modèles de management utilisés par les entreprises, où les objectifs sont fixés de manière scientifique et accompagnés de stratégies concrètes pour garantir leur atteinte. En adoptant une telle approche, on pourrait, par exemple, déterminer des indicateurs précis de progrès, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de bien-être humain et de respect des droits fondamentaux dans la considération raisonnable d’un équilibre global nécessaire.
Les défis budgétaires des collectivités territoriales restent un frein majeur à l’implémentation de véritables stratégies de durabilité. Comment renforcer l’autonomie financière des territoires marocains et encourager des modèles économiques viables qui ne compromettent ni la résilience sociale ni l’équilibre environnemental ?
La durabilité multidimensionnelle nécessite des investissements importants, que ce soit dans la gouvernance propre, les infrastructures, la transition énergétique ou l’amélioration des services publics. Mais ces investissements peuvent se révéler difficiles à assumer territorialement dans un contexte où les ressources sont déjà allouées à des priorités immédiates comme les services de base (éducation, santé, sécurité, etc.). Il reste essentiel tout de même que les collectivités trouvent des solutions innovantes, comme la recherche de financements externes (subventions, création de fonds locaux pour des partenariats public-privé) ou l’adoption de modèles économiques circulaires, pour intégrer les enjeux de durabilité dans leurs politiques tout en respectant les contraintes budgétaires.
Je pense que le secteur privé peut aussi jouer un rôle clé en contribuant à penser et à cofinancer la territorialisation du développement, mais il reste difficile de concilier les objectifs de rentabilité à court terme avec les impératifs de durabilité sociale et environnementale ; là aussi un vrai travail de changement des mentalités devra être entamé dans une logique de convergence et d’optimisation des ressources disponibles.
Votre livre insiste sur la nécessité d’un suivi et d’une évaluation rigoureuse des politiques territoriales. Pourtant, dans la pratique, ces mécanismes restent souvent des outils bureaucratiques déconnectés des réalités du terrain. Comment s’assurer que ces dispositifs ne restent pas de simples formalités administratives, mais deviennent de véritables instruments de pilotage stratégique ?
L’adoption de politiques de développement ne suffit pas en soi ; leur suivi attentif et rigoureux est tout aussi crucial pour garantir leur efficacité à long terme. La durabilité, dans toutes ses dimensions, est l’impératif de notre époque, et le suivi est la clé pour garantir que les politiques mises en place contribuent à un monde plus équilibré, équitable et prospère pour les générations présentes et futures. Ainsi, le concept de durabilité multidimensionnelle et le suivi des politiques de développement sont intimement liés. Les politiques de développement sont initiées et mises en œuvre dans le but de garantir de meilleures conditions socioéconomiques pour tous, mais elles ne peuvent atteindre leur plein potentiel qu’avec une stabilisation dans la durée par un suivi régulier et attentif.
Pour cela, les systèmes de suivi et d’évaluation doivent êtres actualisés et adaptés aux besoins actuels. Ils doivent désormais être pensés comme des processus intégrés de réflexion et de communication qui doivent être planifiés, gérés et dotés de moyens adaptés, et non comme un simple travail de statistique. Il est opportun de renforcer la participation des parties prenantes à travers l’inclusion des acteurs locaux (citoyens, entreprises, associations, etc.) dans le processus d’évaluation pour garantir une vision partagée des enjeux et favoriser l’appropriation des dispositifs de suivi. Je pense également que le suivi-évaluation doit être inscrit dans une logique de responsabilité publique et politique, où les résultats sont partagés avec les citoyens et utilisés comme base pour ajuster les orientations politiques et réorienter les financements si nécessaire et en toute transparence.




